Dans cet article je propose d’explorer comment la santé mentale s’incrit dans une longue tradition psychiatrique et où est-ce qu’elle se niche dans la coercition de nos esprits.
Dans notre contexte politique capitaliste les corps sont considérés comme des ressources à optimiser pour favoriser la productivité. Cette nouvelle organisation de la société occidentale fait émerger la démographie des sciences statistiques ainsi que le développement de la prévention des risques d’invalidité et de mortalité à partir de la Révolution industrielle.
Dans cette répartition nous avons donc d’un côté les corps productifs (vivants et valides) et les corps non productifs (morts ou invalides). Seulement il existe une sorte de troisième catégorie que Foucault appelle les anomalies : ces personnes qui ne répondent pas aux normes institutionnelles et qu’il faut à tout prix maintenir dans le système économique par la création de nouvelles institutions qui leur seront spécifiques1.
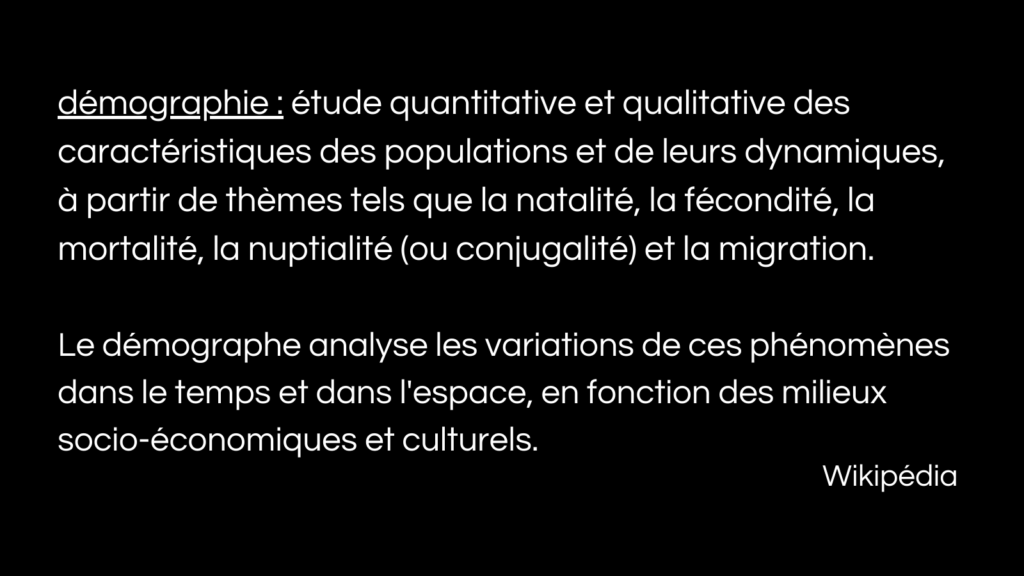
Le grand renfermement du 17e siècle
L’exemple édifiant de cette apparition de la question du corps comme ressource optimisable et de l’institutionnalisation des corps à la marge du système c’est celui de la répression des pauvres qui s’opère en 1656 d’abord à Paris, puis sur tout le territoire français.
À Paris au 17ᵉ siècle on identifie tout un tas d’individus qui posent problème à l’ordre public, les “pauvres mendiants”, et comme solution sera créé l’Hôpital Général où toute personne faisant acte de mendicité y sera corrigée et enfermée. L’Hôpital Général c’est un ensemble d’établissements nommés par le roi qui ont pour ordre de se charger de mettre au travail les pauvres mendiants. Bien qu’il s’agisse d’un “hôpital” il n’y a aucun objectif thérapeutique, donc aucun médecin ou personnel soignant.
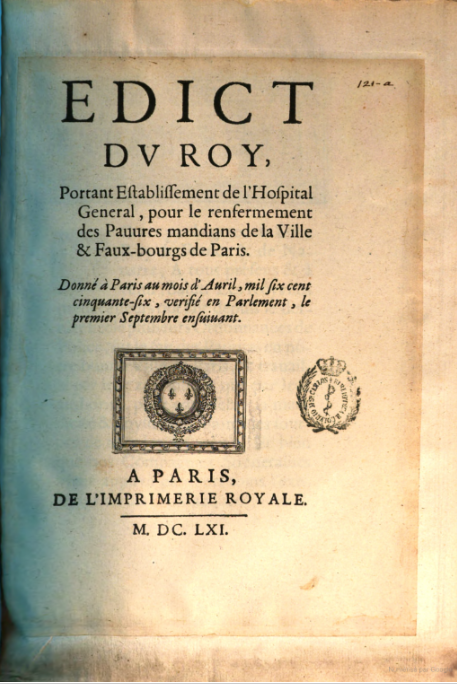
Les Rois nos prédécesseurs ont fait depuis le dernier siècle plusieurs Ordonnances de Police sur le fait des Pauvres en notre bonne Ville de Paris, et travaillé par leur zèle autant que par leur autorité, pour empêcher la mendicité et l’oisiveté, comme les sources de tous les désordres.
[…] voulons et ordonnons, que les Pauvres Mendians valides et invalides, de l’un et de l’autre sexe, soient enfermés dans un Hôpital, pour être employés aux Ouvrages, Manufactures et autres travaux, selon leur pouvoir, et ainsi qu’il est amplement contenu au Réglement […]
Édit promulgué par Louis XIV
Dès lors la mendicité sous toutes ses formes devient interdite, prohibée. Ce qui signifie que toute personne qui gagne de l’argent hors du circuit économique légal se verra enfermée à l’Hôpital Général dont la mission est de ré-intégrer au circuit économique, que ce soit par le maintien du travail à l’intérieur de l’Hôpital ou par le renvoi vers le travail légal à l’extérieur de l’Hôpital.
L’émergence des institutions (18ᵉ-19ᵉ siècles)
Pour comprendre rapidement
C’est à partir du 18ᵉ siècle que la façon de gouverner la population va se concentrer sur la distribution des individus, des temps et des forces de travail en fonction des nécessités économiques. Toute cette stratégie d’optimisation des corps nécessite la mise en place de dispositifs disciplinaires qui vont s’illustrer à travers un lieu précis : les institutions. Elles s’appellent la colonie, l’hôpital, l’école, la prison, l’armée, la psychiatrie, l’atelier, etc.
La psychiatrie apparaît justement entre le 18ᵉ et 19ᵉ siècle lorsque la folie n’est plus considérée comme une erreur de jugement ou de perception (on parlait alors d’insensés), mais comme une force qui n’est pas maîtrisée au point d’en bousculer le comportement du fou. Cette transformation est importante car elle va drastiquement modifier la pratique thérapeutique en passant d’une recherche de guérison par l’accompagnement dans le délire à un rapport de force frontal où la guérison s’obtient lorsque le fou avoue devoir abandonner son délire par crainte de la punition.
Le fou ce n’est plus tant celui qui ne voit pas la réalité parce qu’atteint d’une maladie du raisonnement, mais celui qui ne sait pas se contrôler, résister au mal. Il n’est donc plus question à cette époque de diagnostiquer et de proposer un traitement en fonction d’une analyse clinique, mais d’enfermer et exercer un rapport de force suffisant pour ramener le fou à un comportement considéré normal, c’est-à-dire qui respecte les valeurs morales et les obligations institutionnelles. C’est l’avènement du traitement moral.2
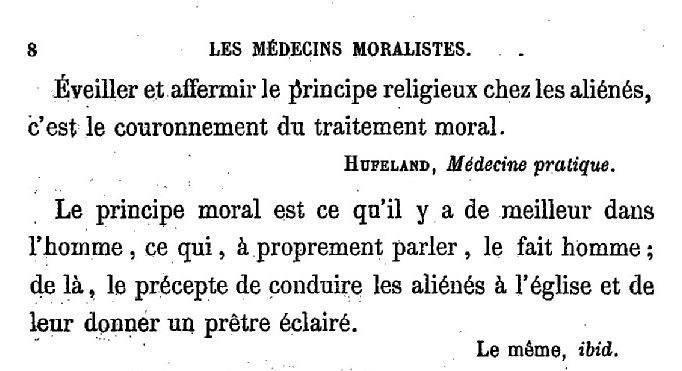
Vous pouvez lire cet article qui parle de cette période : La Reine Charlotte (Bridgerton) : un récit antipsy ?
Pour aller plus loin
Avec la psychiatrie l’objectif n’est donc pas de soulager des souffrances existentielles mais d’empêcher toute sortie de route des individus. Le propre de l’individu, selon Foucault, c’est d’exercer la fonction adaptée à son corps. Dit autrement, un individu c’est un corps dont les caractéristiques biologiques vont se concrétiser dans une fonction optimale pour l’organisation capitaliste. Et vous voyez comment on en vient à nos critères sociologiques de l’individu que sont l’âge, le genre, la race, l’état de santé du corps, etc.*
Seulement comme je l’ai dit au début de cet article, pour faire travailler un individu il ne faut pas se concentrer uniquement sur les critères biologiques du corps, il faut aussi s’assurer que le corps se comporte comme attendu : c’est ainsi que s’organise ce que Foucault appelle le pouvoir disciplinaire. Pour faire court le pouvoir disciplinaire est un dispositif de gouvernance des populations qui privilégie la correction à la peine de mort. On le retrouve dès le Moyen-Âge en Occident dans les communautés religieuses, leurs écoles et leurs colonies. Et c’est à travers elles qu’il va se développer et s’étendre dans les institutions laïques (administration) et devenir le modèle que l’on connaît aujourd’hui.
Chaque institution, parce qu’elle dicte ses normes, produit ses anomalies. La police a son délinquant, l’école a son débile mental et l’armée, son déserteur. Mais alors de quelle institution le fou est-il l’anomalie ? Foucault estime que le malade mental, c’est le résidu de tous les résidus, celui qui ne parvient à s’adapter à aucune institution. Le fou c’est l’anomalie du délinquant, du débile mental et du déserteur. Il sera donc enfermé en hôpital psychiatrique afin de protéger la société de sa dangerosité mais surtout en vu d’être réintégré dans cette même société par un dressage de son comportement, de ses gestes, ses envies, ses désirs, bref, de son corps.
*Je ne donne de légitimité à aucune des catégories individuelles que je cite. Toutes sont à remettre en question puisque toutes répondent à une même logique politique et économique.
De l’hygiène mentale à la santé mentale (19ᵉ-20ᵉ siècles)
L’ apparition de l’hygiène mentale
On attribue la première utilisation de la notion d’hygiène mentale à William Sweetser, un médecin américain du 19ᵉ siècle et auteur de l’ouvrage Mental Hygiene, Or an Examination of the Intellect and Passions, designed to illustrate their influence on health and the duration of life.
Dans les textes anglo-saxons le terme va n’être que très peu utilisé et rapidement abandonné au cours du 20ᵉ siècle au profit de celui que nous connaissons aujourd’hui : la santé mentale.
Ce qu’on appelle hygiène mentale à cette époque c’est l’application des idées de l’hygiénisme à la maladie mentale. La maladie mentale est alors interprétée comme un virus qui peut se propager de personne en personne, et qu’il faut donc limiter par la prévention et la détection précoce (modèle de la prophylaxie). C’est ainsi que la psychiatrie ne doit plus se limiter aux murs de l’hôpital mais s’étendre dans toutes les institutions afin de ne perdre aucun individu.
Cette fonction propre à la psychiatrie Foucault l’appelle la fonction-Psy. C’est la psychopédagogie à l’école, la psychologie du travail, la criminologie en prison et la psychopathologie dans les asiles et la psychiatrie. Cette fonction-Psy, c’est cette discipline psychologique ou psychiatrique qui vise à corriger les anomalies pour les rendre de nouveau normales, avant de devoir définitivement les envoyer à l’hôpital psychiatrique en cas d’échec.
Il faut attendre les années 1940 pour voir un remplacement progressif de la notion d’hygiène mentale par celle de santé mentale. L’année 1960 sera décrétée comme l’ “Année mondiale de la santé mentale“.3
L’impasse de la psychiatrie : l’eugénisme et la théorie de la dégénérescence
Ce remplacement progressif de notion d’hygiène mentale par celle de santé mentale n’est pas le fruit de caprices linguistiques mais s’inscrit au contraire dans un moment historique que l’on oublie souvent quand on défend la psychiatrie : le consensus scientifique occidental autour de la théorie de la dégénérescence.
Pour faire court, la théorie de la dégénérescence implique l’idée selon laquelle il existerait amélioration de l’espèce humaine et donc un type normal de l’humanité. Et comme toute norme produit des anomalies : il y aurait donc des anomalies humaines, des races maladives dégénérées.4
Je ne développe pas ici pour ne pas trop dériver de la question psychiatrique mais ce point pourrait faire l’objet d’un article à part entière.
« Il y aura toujours des déchets dans la société. Les infirmes du cerveau ne disparaîtront jamais, mais l’on peut restreindre considérablement le nombre d’infirmes mentaux si l’humanité veut bien revenir à une vie simple, conforme aux lois naturelles basées sur une saine morale. »
Extrait d’une conférence donnée à la radio, par le Dr. Antonio Barbeau, professeur agrégé à l’Université de Montréal (1931)
À partir de cette science eugéniste de l’hygiène mentale la psychiatrie va pouvoir construire et légitimer son savoir sur les consensus de l’époque : elle attribue des causes génétiques à l’ensemble de ses pathologies et définit le soin par stérilisation forcée des malades mentaux et des individus considérés socialement inaptes pour endiguer le processus dégénératif héréditaire et faire respecter le jeu de la sélection naturelle.
En parallèle la psychanalyse se développe depuis l’École de la Salpêtrière. Elle va à la fois être accusée de science juive par le régime nazi, et devenir l’unique figure de résistance face à l’extension du discours eugéniste sur la folie. Plusieurs analystes juifs vont alors fuir le régime et s’établir un peu partout en Occident. C’est ainsi que la discipline va se populariser en offrant une perspective nouvelle contre une psychiatrie qui enferme et extermine : la thérapie par l’écoute du patient. Développée hors des hôpitaux cette technique qui consiste à donner une place au discours du fou et à lui donner un sens va se réveler décisive après la Seconde Guerre Mondiale. Traumatisées les sociétés occidentales vont s’inscrire en rupture avec la violence des guerres et des totalitarismes : il est temps de faire place à l’humain, d’humaniser les institutions et donc les soins psychiatriques.
Vous pouvez lire cet article qui aborde l’enjeu eugéniste derrière les revendications du diagnostic d’autisme : L’autisme : une maladie ou pas ?
Les origines psychanalytiques de la santé mentale
Inutile de mentionner que pour que le discours sur la santé mentale tienne, celui-ci doit s’appuyer sur le discours psychiatrique. En effet la santé mentale doit être préservée de l’état pathologique mental, autrement dit, de la maladie ou du trouble mental. Mais ce qui semble passer totalement inaperçu avec ce concept ce sont ses postulats psychanalytiques.
Revenons à la définition de ce qu’est la santé mentale. Elle est d’abord un renforcement insitutionnel d’une politique d’hygiène mentale : celle qui nous explique comment, grâce au savoir médical, nous devons réglementer nos comportements afin d’avoir une bonne hygiène de vie. Grâce à ce tour de passe-passe les normes de comportement sont désormais considérées saines, par opposition au pathologique. Ces normes seraient donc naturelles puisque constitutivent de notre bien-être optimal.
« état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté »
Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
Quand on observe la définition de la santé mentale on peut y découvrir des concepts psychanalytiques issus de théories psychodynamiques selon lesquelles les individus évolueraient par phases (enfance, ado, adulte, etc.) liées par des crises, sur un axe d’autonomie compris entre la régression et la maturité.
Ce qu’on appelle régression c’est un retour en arrière dans un processus de développement et un recours à des attitudes et des comportements liés à une phase antérieure du développement. C’est une notion très développée par la psychanalyse, notamment freudienne. En gros, si vous sucez votre pouce après l’enfance : vous régressez. Mais si vous savez parler budget et économies d’argent avant l’âge adulte : vous êtes matures.
Je ne vais pas développer ici mais on y retrouve aussi la théorie de la personnalité et la théorie de l’attachement.
« Jouir de sa santé mentale c’est être capable de créer des liens, d’agir, d’être autonome et de s’épanouir »
Rapport mondial sur la santé mentale, 2022
Un concept qui divise pour mieux régner (de 1940 à nos jours)
Cette définition assez floue de la santé mentale va se juxtaposer à ce que la psychiatrie a déjà produit comme savoir : les troubles psychiatriques peuvent toucher n’importe qui à partir du moment où tout le monde peut vivre des évènements de grande fragilité et donc tomber malade psychologiquement.
Alors comment protège-t-on les gens de la maladie mentale ? Par la préservation de leur stabilité mentale. Et comment protège-t-on les gens de l’instabilité mentale ? En leur apprenant à mieux s’adapter à ce qui leur arrive, la fameuse résilience. Ainsi vous voyez se déployer une logique individualiste qui repose sur la capacité de l’individu à supporter ses conditions d’existence. En effet puisque la santé mentale s’appuie sur la science (démographie), les conditions d’existence telles que le statut professionnel, marital, les ressources financières et sociales, ou encore les évènements climatiques ou géopolitiques ne sont que des facteurs objectifs sur lesquels les gens n’ont, dit-on, pas de pouvoir. Seul terrain où l’on peut agir : les gens eux-mêmes.
L’objectif de la santé mentale c’est donc, premièrement, d’identifier les facteurs externes à l’individu susceptibles de provoquer une crise de santé mentale, et deuxièmement, de préparer l’individu à affronter ces évènements et/ou en limiter les répercussions négatives par une prise en charge.
Avec une telle grille de lecture va apparaître la fameuse notion de souffrance au travail dans les années 40-50. Le travail devient un simple facteur à analyser pour mieux s’y adapter et ainsi éviter tout épisode de santé mentale. Seront identifiés tout un tas de critères qui assurent la bonne productivité, notamment grâce à la naissance du service des Ressources Humaines.
Cette logique institutionnelle faisant aujourd’hui l’unanimité permet de légitimer le savoir psychiatrique en le recouvrant d’une couche de savoir démographique sur les souffrances existentielles, mais aussi d’assurer une observation uniquement à partir de l’individu et de ses souffrances sans jamais remettre en question ce qui les a causées. Elle nous donne l’illusion d’un savoir sur nous-mêmes tout en nous éloignant d’un savoir sur ce qui nous détruit.
La santé mentale n’a jamais été autre chose qu’un prolongement psychanalytique de la psychiatrie. Elle se propose comme un continuum qui ne se résume plus à une présence ou une absence de maladie mentale : tout le monde peut vivre un épisode de santé mentale, juste certains plus que d’autres.
Conclusion
Réaliser que nous avons trop puisé dans nos ressources personnelles pour tenir un rythme de travail considéré comme normal par le management est un burnout pour la santé mentale car il s’agit d’un simple risque de perte de rendement pour l’entreprise à court ou moyen terme. Oui nous sommes reconnus comme souffrant d’épuisement professionnel, mais cela ne dit rien des conséquences que cela aura pour nous, que ce soit professionnellement, économiquement, affectivement ou physiquement. Les médecins nous proposeront des antidépresseurs, quelques jugements sur notre incapacité à nous donner des limites au travail, à nous organiser, à équilibrer vie pro/perso, et puis peut-être nous verrons-nous ensuite orientés vers un psychologue pour nous lancer dans une thérapie censée nous aider à y voir plus clair dans notre rapport psychologique au travail.
Quid des politiques managériales de notre entreprise ? Des objectifs toujours plus élevés ? Des félicitations les jours où l’on était dans le rouge et des traits d’humour quand on quitte notre poste à l’heure ? Quid aussi du chantage au sous-effectifs pour nous culpabiliser de ne pas être assez solidaire des équipes, de ces salaires qui stagnent malgré l’inflation, de ces emplois qui ne respectent pas les droits des travailleurs et poussent à se mettre en danger pour pouvoir survivre un mois de plus ?
La santé mentale est un savoir qui ne s’est pas construit sur nos souffrances mais sur les risques de pertes humaines au profit d’une exploitation optimisée de nos corps. Le reflet d’une connaissance de nos douleurs les plus profondes n’est dû qu’à la corrélation entre les dégâts systémiques provoqués par l’exploitation colonialiste et patriarcale (traumatismes, maladies, accidents, invalidités, décès) et nos crises existentielles. Il n’y a pas d’autre objectif que de nous maintenir en état de productivité. Une bonne santé mentale ne s’entend que lorsque nous sommes en mesure d’apporter quelque chose à la société par la production (tant que cette production s’inscrit dans le circuit économique reconnu par les normes capitalistes).
Est-ce que toutes les souffrances psychologiques s’inscrivent réellement dans ce concept de santé mentale ? Quel discours devons-nous avoir vis-à-vis des sociétés génocidées : s’agit-il d’un épisode de santé mentale un peu plus long que prévu ? Existe-t-il des populations plus fragiles que d’autres et donc plus susceptibles de souffrir des traumatismes perpétrés par les États coloniaux ? N’est-ce pas absurde et irrespectueux d’invidualiser des vécus partagés par des communautés entières qui subissent les atrocités les plus inommables au nom de ce même système capitaliste pour lequel nous cherchons à nous réguler pour mieux produire ?5
Dès que l’on accepte de regarder un peu plus loin que notre propre situation, on ne peut continuer de raisonner en “santé mentale” tant cette logique individualiste fait offense à notre empathie la plus élémentaire. Ce concept, aussi creux qu’efficace, n’a jamais aussi bien fonctionné que parce qu’il agit sur notre résignation à lutter collectivement. En plus de s’inscrire dans un idéal méritocratique de la santé et du bien-être, il ne fait que renforcer notre désengagement communautaire en nous déracinant jusque dans nos traumatismes les plus collectifs tout en nous proposant de chercher en nous-mêmes les fautes de ceux qui nous exploitent jusqu’à la mort.
Sources :
- Michel Foucault, Le pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France. 1973-1974. Paris, Gallimard, 2003, 393 p. ↩︎
- Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique. Paris, Gallimard, Tel, 1972, p. 70. ↩︎
- DORON Claude-Olivier, « L’émergence du concept de « santé mentale » dans les années 1940-1960 : genèse d’une psycho-politique », Pratiques en santé mentale, 2015/1 (61e année), p. 3-16. https://www.cairn.info/revue-pratique-en-sante-mentale-2015-1-page-3.htm ↩︎
- Anne-Laure Simonnot, Hygiénisme et eugénisme au XXe siècle à travers la psychiatrie française. Seli Arslan, 1999, 190 p. ↩︎
- Ayesha Khan, PH.D., Our distress & mental health issues are not caused by biological defects
https://wokescientist.substack.com/p/our-distress-and-mental-health-issues ↩︎
